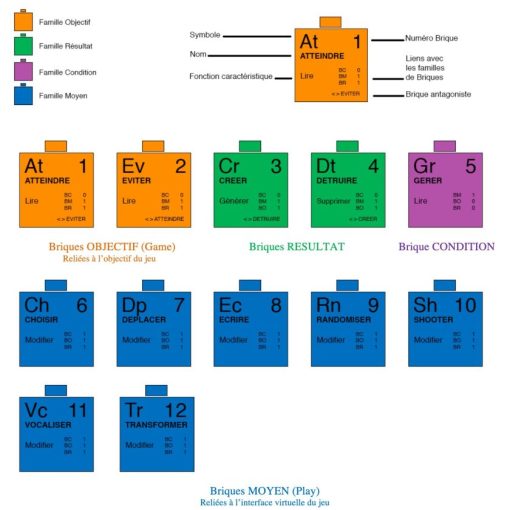Qu’est-ce que le Game Design ?
Le game design est l’art de créer et de concevoir des jeux. Il s’agit d’un processus créatif complexe qui mélange narration, technologie et esthétique pour offrir une expérience de jeu unique et immersive. Les game designers sont responsables de nombreux éléments, notamment :
- La conception des règles du jeu
- Les mécanismes de jeu (gameplay)
- Les niveaux et la progression du joueur
- Les personnages et leurs interactions
Le game design repose sur une compréhension fine des attentes des joueurs et nécessite une combinaison de compétences artistiques, techniques et analytiques. Il travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des autres corps de métier impliqué dans la conception d’un jeu vidéo (level designer, sound designer, programmeur, UX designer, etc.)
Les étapes clés du Game Design
Le travail d’un game designer ne se limite pas à imaginer des règles de jeu amusantes ou des environnements visuellement plaisants. Il s’agit d’un processus complexe qui implique une réflexion approfondie sur plusieurs éléments essentiels. Voici les principales étapes qu’un game designer doit prendre en compte lors de la conception d’un jeu vidéo.
- L’intention de jeu Chaque jeu doit avoir une intention claire. Que veut-on faire vivre au joueur ? Quelles émotions, expériences ou réflexions souhaite-t-on susciter ? L’intention peut aller de l’idée de divertir à celle d’apprendre, en passant par l’immersion dans une histoire ou un univers spécifique. Cette intention guidera tous les choix de conception par la suite.
- Connaissance des utilisateurs (les joueurs) Il est primordial de comprendre qui sont les futurs joueurs. Quelles sont leurs habitudes, leurs compétences, leurs motivations ? Le public cible va influencer de nombreux aspects du jeu, notamment la complexité des mécaniques, le style visuel, et même la narration. Les attentes des joueurs doivent être prises en compte dès le début du processus pour créer une expérience qui leur parle.
- L’expérience utilisateur (UX design) L’UX design vise à rendre l’expérience du joueur la plus fluide et agréable possible. Cela inclut les contrôles, qui doivent être intuitifs et réactifs, ainsi que l’interface utilisateur. Un jeu peut être génial sur le plan narratif ou mécanique, mais si l’expérience utilisateur est frustrante, il ne trouvera pas son public. Le défi consiste à anticiper les besoins des joueurs et à réduire les points de friction.
- Les objectifs du jeu Les objectifs, qu’ils soient explicites ou implicites, donnent un sens au jeu. Ils permettent au joueur de savoir quoi accomplir et donnent une direction à son action. Ces objectifs peuvent être simples (comme collecter des ressources ou atteindre un score) ou plus complexes (comme résoudre des énigmes ou faire des choix moraux impactant l’histoire). Les objectifs doivent être clairs tout en laissant une certaine liberté d’action.
- Les feedbacks Les retours fournis au joueur pendant sa progression sont essentiels. Ils lui indiquent s’il avance dans la bonne direction, s’il réussit ou échoue. Les feedbacks peuvent être visuels, sonores, ou même tactiles (avec la vibration d’une manette par exemple). Un bon équilibre entre récompenses et punitions aide à maintenir l’engagement et à renforcer la motivation.
- Les mécaniques et la boucle de gameplay Les mécaniques de jeu représentent les actions et interactions possibles dans le jeu. Elles doivent être claires, équilibrées et stimulantes. La boucle de gameplay (l’ensemble d’actions que le joueur répète tout au long du jeu) doit offrir des défis et des récompenses régulières pour maintenir le joueur dans l’action. La progression est un élément crucial ici : le joueur doit sentir qu’il s’améliore, tout en rencontrant de nouveaux défis à chaque étape.
- Les choix laissés aux joueurs Les jeux qui permettent aux joueurs de faire des choix significatifs, qui impactent l’issue de l’histoire ou la progression, créent une connexion émotionnelle plus forte. Ces choix peuvent aussi influencer le gameplay, la stratégie adoptée, et ainsi enrichir l’expérience. Laisser le joueur s’approprier son parcours est souvent un gage d’immersion et de satisfaction.
- L’impact émotionnel Un bon jeu doit provoquer des émotions chez le joueur. Cela peut être la tension, la joie, la tristesse, l’excitation, ou même la peur. L’aspect émotionnel est souvent lié à la narration, mais aussi aux défis proposés ou aux relations que le joueur peut établir avec le monde et les personnages du jeu.
- L’environnement concurrentiel Les game designers doivent également considérer l’environnement concurrentiel. D’autres jeux similaires existent-ils déjà ? Si oui, comment se différencier tout en s’appuyant sur des mécanismes que les joueurs reconnaissent et maîtrisent déjà ? Il est parfois utile de se baser sur des codes de genre ou des mécanismes éprouvés pour faciliter la prise en main du jeu, tout en apportant des innovations pour se démarquer.
- Le business model Enfin, le game designer doit aussi prendre en compte le modèle économique du jeu. S’agit-il d’un jeu payant, d’un jeu free-to-play avec des microtransactions, ou d’un modèle basé sur des abonnements ? Ce choix influence directement le gameplay et l’expérience utilisateur. Par exemple, un jeu free-to-play pourrait proposer des mécaniques de progression plus lentes pour encourager les achats in-game.
Game designer = penser le flow des joueurs
Le flow est un état psychologique dans lequel un joueur est totalement immergé dans une activité, atteignant un niveau maximal de concentration, d’engagement et de satisfaction. Ce concept a été défini par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi en 1975.
Pour que le joueur entre dans cet état, le jeu doit constamment ajuster son niveau de difficulté de manière à maintenir un équilibre entre challenge et compétence. S’il est trop facile, le joueur s’ennuie ; s’il est trop difficile, il se décourage.
En game design, l’objectif est de créer une progression où les joueurs deviennent plus forts sans être découragés, tout en leur offrant des récompenses significatives et des feedbacks adaptés. Le célèbre game designer Ralph Koster illustre cette idée dans A Theory of Fun en affirmant que « with games, learning is the drug ». Pour lui, l’essence du fun réside dans l’apprentissage et la progression constante.
Du Game design au Play design : se concentrer sur l’expérience des joueurs
Traditionnellement, on parle de game design pour désigner l’ensemble des règles, mécaniques et systèmes qui structurent un jeu. Cependant, certains chercheurs et concepteurs de jeux préfèrent utiliser le terme play design, afin de déplacer l’attention vers l’expérience vécue par le joueur.
L’idée derrière le play design est de concevoir des systèmes qui ne se concentrent pas uniquement sur les règles, les défis ou la structure du jeu, mais plutôt sur l’interaction dynamique entre le joueur et le jeu. Cela implique de créer des environnements, des mécaniques et des situations où le joueur peut s’approprier le jeu de manière personnelle, créant ainsi une expérience unique à chaque partie.
“L’expérience ce n’est pas un noyau de subjectivité isolée, c’est un agencement et une manière de faire circuler du désir dans cet agencement”.
Martin Lefebvre, Mathieu Triclot, « Penser l’ expérience du joueur. Entretien avec Mathieu Triclot. » <www.merlanfrit.net>, 29 novembre 2011, disponible en ligne : <www.merlanfrit.net/Penser-l-experience-du-joueur>.
Dans cette perspective, le play design met en avant plusieurs éléments clés :
- La liberté du joueur : Le joueur doit pouvoir explorer, expérimenter, et parfois même détourner les règles à sa manière. Un bon play design encourage la créativité et l’improvisation, permettant au joueur de se sentir acteur de son expérience.
- L’adaptation aux différents profils de joueurs : Plutôt que de concevoir des défis universels, le play design cherche à offrir des expériences adaptées à chaque joueur. Cela rejoint la théorie du flow, où il s’agit de maintenir un équilibre constant entre le niveau de compétence du joueur et la difficulté des défis. Les jeux qui s’adaptent en fonction des performances des joueurs permettent de maintenir un engagement constant et évitent le découragement ou l’ennui.
- L’interaction et l’émotion : Le play design met un fort accent sur l’impact émotionnel des interactions. Plutôt que de voir les mécaniques comme de simples règles abstraites, il s’agit de considérer comment ces règles sont vécues par le joueur et quelles émotions elles suscitent : excitation, frustration, fierté, ou encore la surprise.
- Des jeux plus ouverts : Dans un modèle de play design, il est courant de voir des jeux qui permettent des approches multiples, où le joueur peut définir ses propres objectifs ou choisir parmi une variété de stratégies pour accomplir les tâches proposées. Les jeux en monde ouvert ou les sandbox games (comme Minecraft) sont des exemples frappants où la structure laisse place à une expérience plus libre et personnalisée.
Si le game design se concentre sur la construction de systèmes équilibrés et bien définis, le play design se concentre sur la manière dont ces systèmes sont perçus, expérimentés et parfois même transformés par le joueur. Il ne s’agit pas d’une opposition entre les deux termes, mais d’une complémentarité. Le game design crée les fondations, les règles du jeu, tandis que le play design s’assure que ces règles permettent une expérience de jeu fluide, enrichissante, et engageante pour chaque type de joueur.